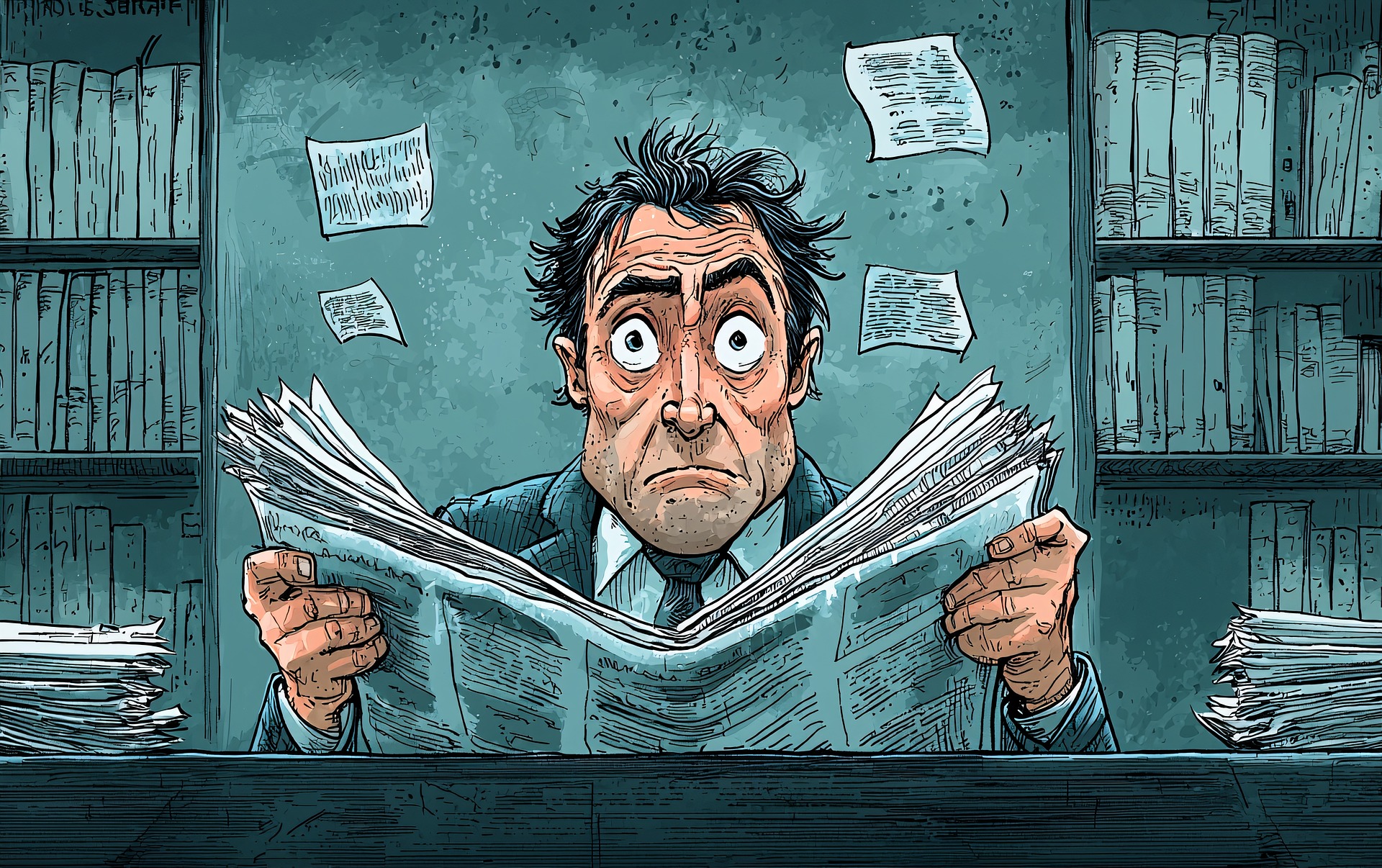Qu’est-ce que le traitement médiatique du fait religieux en Suisse romande révèle sur l’évolution de la construction sociale du religieux ? Participe-t-il à l’exculturation des religions dont parlent de nombreux sociologues ? Jean-Christophe Emery nous propose quelques pistes de compréhension.
Musulmans fanatisés, catholiques pédophiles, orthodoxes va-t-en-guerre et évangéliques complotistes témoignent de la forte présence du religieux dans les médias. […] Ces clichés fonctionnent d’autant mieux dans l’espace médiatique que de larges pans de la population disposent de connaissances limitées, voire sommaires en matière religieuse.
Le traitement du fait religieux ne fait l’objet d’aucun cours spécifique dans la formation des journalistes, [ce qui] induit des biais importants : l’exacerbation de clichés, l’incapacité d’entrer dans la complexité des traditions et l’usage de simplifications fautives.
Des stratégies de personnification, de dramatisation et de polarisation de l’information visent à conquérir un marché restreint soumis à une forte concurrence. […] Les facteurs économiques pèsent sur la qualité du traitement de l’information, la capacité de mener des enquêtes (plus coûteuses) et le nombre de professionnels en poste. […] Les mécanismes complexes qui interviennent dans la mise en visibilité du religieux se heurtent aux nécessités de simplifier l’information pour la rendre accessible au plus grand nombre.
Autour de la perception du religieux se cristallisent des propos ambivalents et des a priori péjoratifs. […] A contrario, un intérêt pour le spirituel individuel, aux connotations souvent plus positives, est perçu comme une forme de développement de soi, d’épanouissement et de préoccupation écologique (p. ex. la méditation). Souvent, il n’est pas associé à l’institution qui pourtant le porte.
Les médias participent à la mise en scène du religieux et à sa transformation*. Leurs choix de traitement constituent des éléments de construction sociale. Ils […] induisent des représentations dans le domaine du croire, […] participent du processus de désaffiliation (croire sans appartenir) […] et entretiennent avec le religieux une relation ambivalente par la diabolisation de toute prétention d’absolu, tout en cultivant une fascination pour certaines figures ou traditions. […] Parfois, ils aplatissent [la] complexité [du religieux] par des logiques d’essentialisation. […] Ainsi, le traitement médiatique du religieux me semble particulièrement emblématique de cette exculturation des religions dont parlent de nombreux sociologues**.
[Or,] le bon fonctionnement critique du fameux quatrième pouvoir est essentiel à la démocratie. [Heureusement,] l’immense majorité des acteurs [et actrices] de la profession exerce son art […] avec un haut degré de professionnalisme.
*Pierre BRÉCHON et Jean-Paul WILLAIME (éd.), Médias et religion en miroir, Paris, PUF, 2000.
** Je renvoie ici à titre d’exemple aux textes de Danièle Hervieu-Léger.
Cet extrait provient de l’article « Du religieux dans les médias » de Jean-Christophe Emery. Il est disponible dans le n°52 de la Revue des Cèdres : Le dialogue pour religion